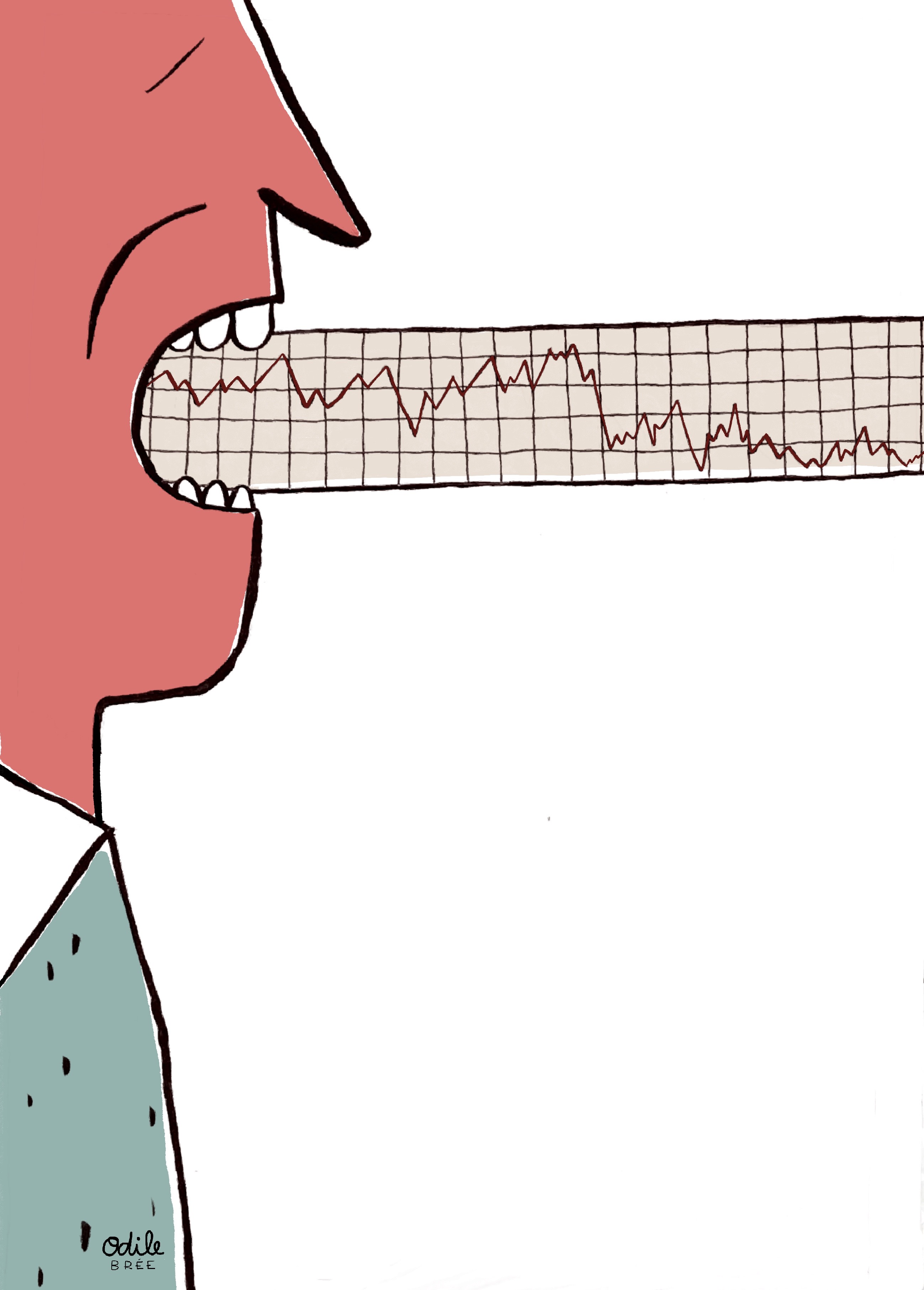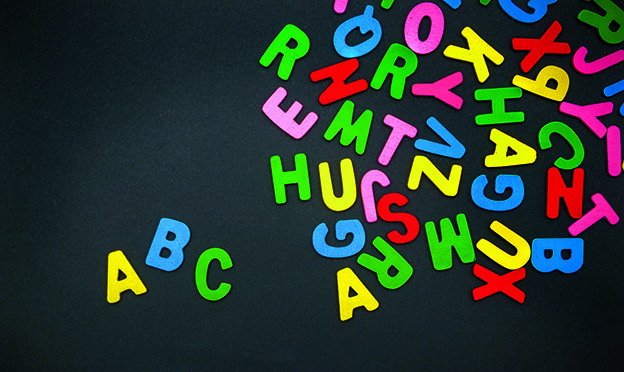"C’est la crise!"... Cette phrase à l’allure de sentence traverse les époques. On pourrait même dire qu’elle a toujours eu une place de choix dans notre champ lexical.
À l’approche de l’opération "Les mots nous rassemblent", Présence s’intéresse aux mots de la crise, plus particulièrement celle de la COVID-19, ainsi qu’à leurs impacts sur nos habitudes langagières.
Aujourd'hui, la crise sanitaire est au devant de la scène. À sa source ou à sa suite, d'autres fractures, plus ou moins profondes atteignent les différentes couches de la société : crises sociales, économiques, écologiques, gouvernementales... Pour chacune de ces crises, il existe une approche terminologique, un discours descendant des autorités vers le peuple.
Le langage est l’un de nos premiers liens avec le monde. En utilisant les mots, nous arrivons à communiquer et à donner un sens aux choses que nous voyons, aux odeurs que nous sentons, aux sensations de notre peau, aux bruits que perçoit notre ouïe... Il est donc parfaitement naturel que ce qui nous "touche" fabrique du langage. Le coronavirus n'échappe pas à cette loi générale de la créativité sémantique: "gestes barrières", "quarantaine", "confinement", "distanciation"...
Lorsque nous atterrissons dans un pays dont la langue nous est étrangère, nous nous trouvons dépourvu·e·s d'un langage précis pour nous guider face à un environnement inconnu. C'est aussi ce qui nous est arrivé avec l'apparition de la Covid-19 dans le monde. Notre vocabulaire a été peuplé chaque jour par des termes et des expressions jusqu'alors peu ou pas utilisés.
Un discours, un discours!
Les dirigeant·e·s se sont appuyé·e·s sur le langage pour réagir à la crise sanitaire, chacun·e à sa manière. En France, l'exemple le plus marquant est bien évidemment le discours du 16 mars d'Emmanuel Macron. "Nous sommes en guerre", a-t-il répété, six fois. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, le coronavirus était "le plus grand défi" de son pays depuis la Seconde Guerre Mondiale. La reine Elizabeth II, se voulant rassurante, a affirmé: "Nous vaincrons".
En Belgique, Sophie Wilmès (MR) s’est retrouvée propulsée aux manettes du Gouvernement fédéral, le pays étant lui-même traversé par une crise gouvernementale depuis le 21 décembre 2018. Dans sa première allocution télévisée du 17 mars dernier, pas de métaphores guerrières comme Emmanuel Macron, mais un appel au bon sens de chacun·e avec en guise de conclusion: "Prenez soin de vous, prenez soin des autres." Du côté des Amériques, Donald Trump compare le virus à celui de la grippe. Suivant ses pas, le président brésilien Jair Bolsonaro a fait un discours à contre-courant du reste du monde, en incitant la population à "continuer à vivre normalement".
Des mots sur les maux
Aujourd’hui, on ne peut plus chercher "ennemi invisible" sur Google sans tomber sur des articles autour du coronavirus. Ensemble, nous "luttons contre" cet adversaire microscopique. Nous respectons les "gestes barrières" et le "confinement". Les discours se sont répandus dans notre langage quotidien et nous n’hésitons plus à l’utiliser pour décrire cette période que nous vivons.
Source :
Face à la crise du COVID-19, le langage comme mécanisme de défense, Alternego, Marcos Fernandes, 15 avril 2020
Entretien
"Le langage rate toujours sa cible"
Rencontre avec Antoine Blanchard, historien de formation et animateur au CIEP (Centre d’Information et d’Éducation Permanente). Il proposera en novembre à Dison une conférence-débat pour mieux comprendre les épidémies modernes.
L'étymologie du mot crise, krisis en grec, est polysémique, mais son interprétation laisse penser que c’est un moment décisif avec en perspective un changement profond. Ne se fait-il pas attendre?
Antoine Blanchard : On a effectivement l’impression d’être dans une crise permanente, ce qui implique qu’on a du mal à voir que c’est un moment de bascule. Cela est dû aussi à notre économie, qui rend difficile le fait de considérer que les choses prennent du temps, que ce sont des processus longs. Ces deux derniers siècles, le dénominateur commun de ces crises est notre mode de production capitaliste, qui implique lui-même un certain rapport au monde, un rapport social aussi. Il y a d’autres causes extérieures, c’est un mécanisme complexe, mais je parle ici du mode capitaliste comme système civilisationnel, qui prend cours dans bien des aspects de nos vies quotidiennes. Le travail, la nature et l’argent sont devenus des marchandises, ça vient enrayer la machine et le système se coupe l’herbe sous le pied, ça devient une crise à l’intérieur du système.
L'expression "c'est la crise!" semble avoir toujours fait partie de notre langage quotidien. Est-ce qu’être une société en crise est devenu banal?
Il y a une grande focalisation sur cette crise sanitaire qui met un coup d’écran sur toutes les autres. C’est comme un iceberg, la crise épidémique est la face immergée du glacier, mais elle révèle ou accélère toute une série d’autres dimensions moins visibles. Une crise peut en cacher une autre!
On voit aussi l’importance dans le choix des mots des gouvernants et ce que ça suscite dans les populations.
Ce qui est frappant, c’est que des cultures politiques – voire des cultures au sens large – proches géographiquement peuvent agir différemment. En Hollande par exemple, les mesures prises étaient différentes des nôtres. Les moments de crise sont aussi des révélateurs pour ça. Même s’il y a des homogénéités entre les pays, un système civilisationnel unique, un mode capitaliste... des disparités existent. Plusieurs analystes sérieux évoquent l’idée que les gouvernements d’Europe occidentale agissent aussi en fonction de leur base électorale, de manière à conserver le pouvoir. Cela participe à ces contrastes d’un pays à l’autre. D’une certaine manière, les pouvoirs ont profité de cette crise de défiance et de méfiance pour réaffirmer des leaderships, pour dire "regardez, on a un pouvoir fort".
On voit la vitesse avec laquelle les gens se sont approprié les termes de cette crise, les comportements aussi.
On se pense émancipés du pouvoir, que c'est une sphère d'inflluence qui ne nous touche pas, mais c’est beaucoup moins le cas qu’on le croit. Dans cette crise, c’est assez manifeste, et cela s’explique : les épidémies sont des moments particulièrement traumatisants, a fortiori à notre époque très hygiéniste, où la mort et déniée et où l’on pensait pouvoir éradiquer toutes les maladies infectieuses. C’est intéressant de voir à quel point nous avons répondu présents.
Contrairement à d’autres crises, la COVID-19 se manifeste de façon plus visible. Nos réactions sont-elles liées à ce rapport de proximité?
Oui, ça nous touche ici maintenant. Des gens de notre entourage sont malades, certains en meurent, ça va de soi. Les épidémies sont en explosion depuis les années 70-80 et précisément les épidémies qui sont d’origine animale, qu’on appelle des "débordements zoonotiques". Ce sont des virus qui circulent chez les animaux et qui, à cause de l’activité humaine, la déforestation, l’urbanisation, se transmettent plus facilement des animaux sauvages vers l’humain. Nous nous sommes peu émus par exemple de la énième vague du virus Ebola en 2014 ou du Zika. Ce sont pourtant des épidémies très violentes, le taux de mortalité de l’Ebola est à 50%. C’était loin de nous, on ne se sentait pas concernés. La COVID-19 a touché d’abord et avant tout l’Europe, les pays riches, c’est précisément parce qu’il a touché celles et ceux qui sont en première loge dans le théâtre du monde que la réaction a été plus importante.
Les discours scientifiques dissonants ont participé à ce brouhaha médiatique.
La science est l’un des discours dominants de nos sociétés depuis une cinquantaine d’années. C’est un discours d’autorité. En réalité, c’est normal qu’il y ait des désaccords entre les scientifiques, il y a des différences de protocoles, de présupposés. C’est un peu traumatisant pour les gens d’imaginer que la réalité de la science n’est pas celle que l’on croyait, mais ça ne veut pas dire que l’objectivité n’existe pas. Objectivité et vérité sont des termes très importants, mais qui n’impliquent pas toujours ce que l’on pense. La vérité, ce n’est pas celle avec un grand V, qui préexiste à tout. Il ne faut pas s’arrêter à la surface, mais tenter de comprendre pourquoi un scientifique va dans cette direction-là et l’autre ailleurs. Chaque expert met des éléments différents dans son dispositif d’analyse.
Peux-tu nous en dire plus sur la conférence du 26 novembre à Dison?
Il s’agit d’une conférence-débat, pour comprendre c’est que sont les épidémies, d’où elles viennent, avec une approche historique et un focus particulier sur les mots de la crise. C’est une façon de faire une mise en perspective des choses, de les mettre à distance pour mieux se les réapproprier. Le langage nous préexiste, c’est le siège de la représentation, du symbolique. Le langage ne dit jamais le vrai, il rate toujours sa cible quelque part, mais c’est comme ça qu’il touche le réel, c’est notre façon à nous, les êtres humains, d’appréhender le monde. C’est fondamental d’en prendre conscience, c’est ça notre réel, notre langage et le rapport complexe, difformant qu’il a au monde.